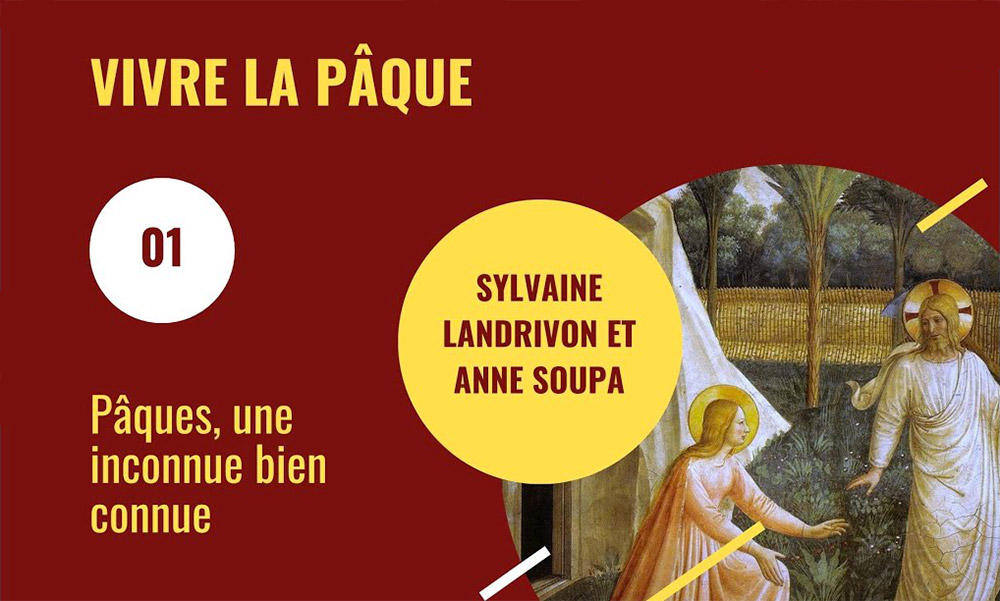À la une
Notre Actualité
Le comité de la Jupe a fêté ses 15 ans !
Le comité de la Jupe a fêté ses 15 ans ! Dans un exercice de rétrospective, Anne Soupa, l’une des deux fondatrices du comité de la jupe, a d’abord retracé les tout [...]
La peur – Compte Rendu
La peur - Compte rendu Dimanche 24 mars à la Maison Chavril tenue par les Oblats de Marie, près de Lyon, Przemek nous accueillait pour une représentation de la pièce de François [...]
Célébration pour la semaine sainte
Célébration pour la semaine sainte La semaine Sainte nous propose de suivre Jésus pas à pas, de l'entrée à Jérusalem jusqu'à sa résurrection. Le Comité de la Jupe vous propose donc une [...]
Notre Vlog
webmaster_esther2021-04-06T20:18:42+01:00
webmaster_esther2021-04-26T15:56:03+01:00